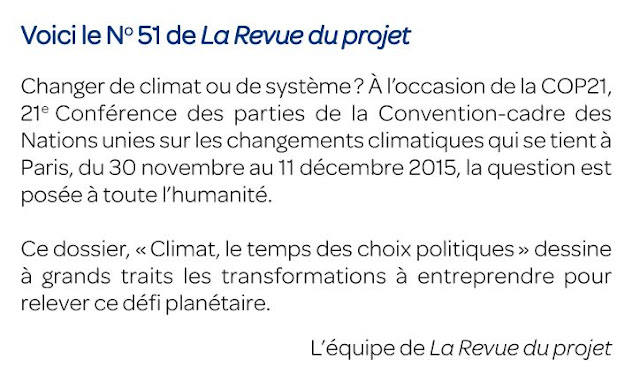Article de Léo Lepinçon pour Cahiers d'Histoire
Roger Martelli, Pour en finir avec le totalitarisme - Éd. La Ville Brûle, 2012, 160 p.
Ancien membre du comité directeur du PCF, membre fondateur de la fondation Copernic et actuellement codirecteur de la revue Regards, Roger Martelli a publié de nombreux ouvrages sur le concept de nation et sur l’histoire du communisme français (1.)
Ce livre, publié aux éditions « La Ville Brûle (2) », porte toujours sur le communisme mais s’intéresse à une dimension particulièrement délicate : son assimilation aux idéologies totalitaires et, via le stalinisme, au fascisme italien et au nazisme allemand. Cet ouvrage s’adresse à un public déjà intéressé par les questions soulevées et c’est autant un essai sur les totalitarismes qu’une analyse militante de la question.
Partant du constat que, depuis 1995, les programmes scolaires français présentent le totalitarisme en assimilant sans distinguer nazisme, fascisme et stalinisme et que, depuis 2011, on y a ajouté l’expérience soviétique entière (de 1917 à 1991), l’auteur entend déconstruire le concept de « totalitarisme », lui préférant le qualificatif « totalitaire ». Il reconnaît que comparer les trois grands systèmes apporte éclaircissements et précisions sur les mécanismes mis en œuvre lors des processus de totalisation, mais leurs différences, particulièrement idéologique, les rend incompatibles. Sans nier le totalitaire, le « totalitarisme » désigne des régimes, certes liés par un projet commun (création d’une société nouvelle dans le pays ou dans son aire d’influence), mais dans lesquels le totalitaire ne s’est réalisé ni selon les mêmes modalités, ni au même degré, ni pour les mêmes raisons. C’est un mot-concept dont « l’insuffisante rigueur de son abstraction brouille l’analyse davantage qu’elle ne contribue à l’éclairer » (3). Le concept, car il confond les trois systèmes (4), est un raccourci intellectuel et politique. Il en dénonce la « fétichisation libérale » (5) par les adeptes du libéralisme à des fins politiques : le xxe siècle aurait été dominé par l’opposition structurante du libéralisme politico-économique des démocraties occidentales face aux totalitarismes. Cependant, le premier n’a, selon l’auteur, jamais été « autre chose qu’un mythe » (6). Le concept totalitariste « veut dédouaner le parti pris libéral des errements de l’histoire contemporaine » (7). Pour son étude, il privilégie une « histoire globale où les idées, les intentions, les organisations, les pratiques, les trajectoires individuelles et les destins partagés s’entremêlent sans se confondre » (8), sur un « tableau statistique » (9) trop « idéologique » (10).
Le premier chapitre retrace l’origine du concept de totalitarisme, et Roger Martelli montre que son utilisation a été tributaire du contexte géopolitique du « court xxe siècle » (E. Hobsbawm). L’auteur dresse une historiographie du sujet, permettant de montrer la variété des analyses produites (11) et la diversité des écoles de pensée depuis 1945, sur la question du totalitarisme et du communisme.
Ensuite, il entend appliquer la définition à l’analyse des régimes. S’il annonce que des ressemblances entre les systèmes peuvent apparaître, elles ne suffisent pas à faire leur identité. La genèse des trois régimes est liée au traumatisme de 1914-1918 et remettent radicalement en cause la société existante, mais l’auteur place leurs origines en opposition. Les fascismes sont nés en réaction à l’idéal des Lumières, alors que « le stalinisme, surgeon monstrueux du marxisme, s’inscrit dans la continuité des Lumières pour en compléter l’incomplétude et non le pari égalitaire originel » (12). Fascisme et nazisme appartiennent à la même galaxie : projets et idéologies d’inspirations similaires (la race allemande et la nation italienne) où le chef occupe la place centrale ; la violence et l’étatisme sont plus ou moins assumés. Pour le stalinisme, le culte de la personnalité est une imposition, étrangère au marxisme. Si le communisme implique la fondation d’une société sans classe, dans la pensée marxiste, la dictature du prolétariat n’est pensée que transitoirement, pour, à terme, amener l’abolition de l’État. Le stalinisme a fait le contraire : il a renforcé le pouvoir étatique. Si tous font usage de la violence et de la terreur, ce n’est pas dans la même logique. Violence intrinsèque et assumée d’un côté, elle est censée être transitoire en URSS. La NEP de Lénine se voulait un relâchement de l’emprise issue du communisme de guerre. Mais l’accession de Staline au pouvoir marque l’arrêt de cette expérience que Staline ne voit que comme un « expédient provisoire » (13). La terreur et la violence des années 1920-1930 relèveraient plus de l’emballement d’une machine répressive issue des premières années difficiles de l’URSS, que d’une volonté exterminatrice. C’est une entreprise destructrice qui « se développe en processus chaotique et largement incontrôlé » (14). D’un côté, « le totalitaire du fascisme et du nazisme conserve […] le fil d’une cohérence de culture et de projet, [de l’autre] le totalitaire des années staliniennes d’avant-guerre » (15) est la négation du projet initial, doublée d’une fuite en avant incontrôlable. Le nazisme et le fascisme sont vaincus de l’extérieur, alors que l’URSS s’est effondrée d’elle-même. Après 1954, le stalinisme s’atténue, l’URSS est « poststalinien[ne] mais pas démocratique » (16). Martelli y voit donc un système voué à l’échec qui se reproduit pragmatiquement, mais de moins en moins efficacement et qui est « donc de moins en moins totalitaire » (17).